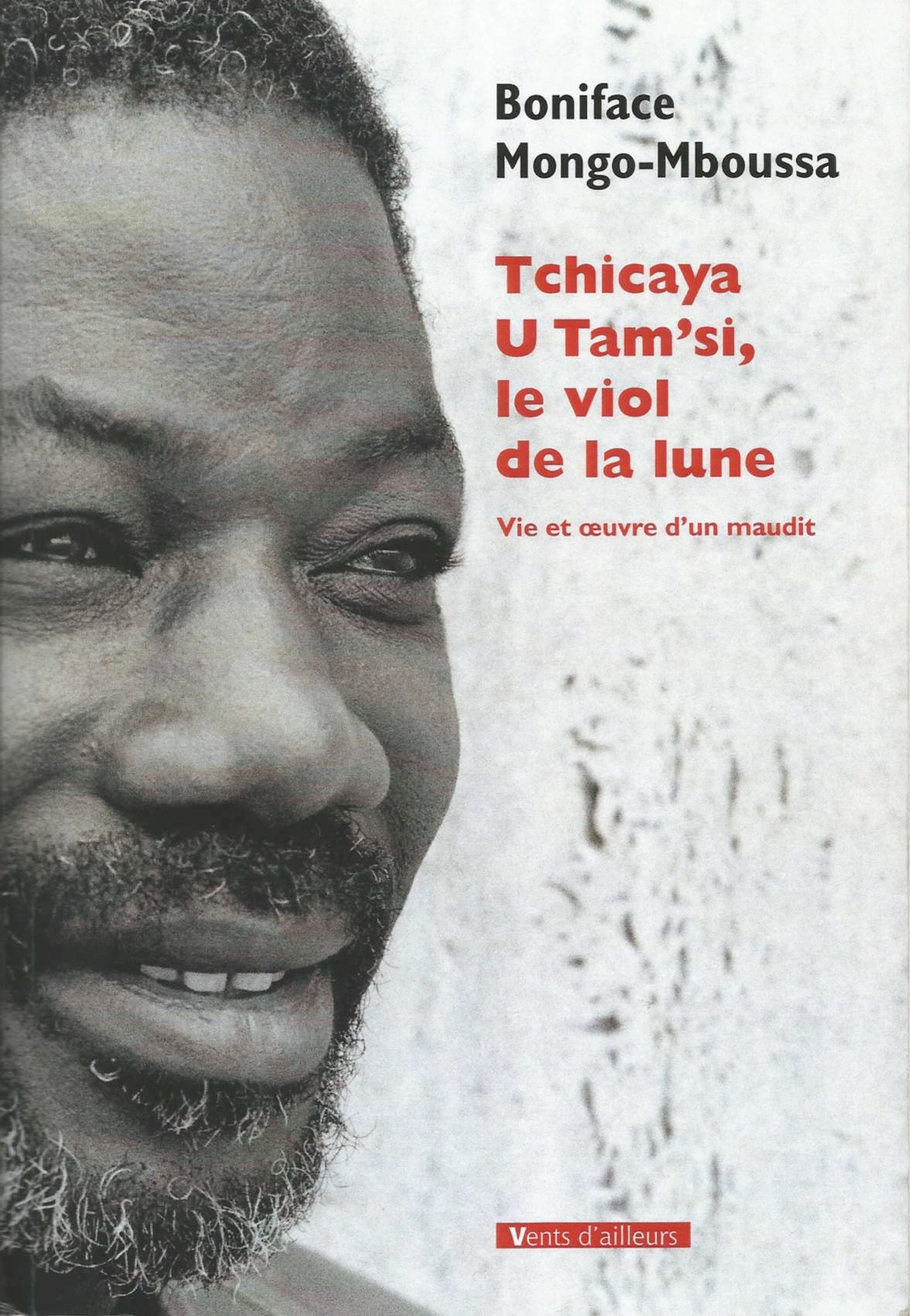Boniface Mongo-Mboussa : « Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune. Vie et œuvre d’un maudit »Samedi 6 Septembre 2014 - 6:00 Fils de Jean Félix-Tchicaya (député du Moyen-Congo et du Gabon à l’Assemblée nationale de la Constituante de 1946 à 1958), Gérald est séparé de sa mère à quatre ans et va vivre avec son père et sa belle-mère ainsi que toute la progéniture que ce couple d’« évolués » engendre par la suite. Son premier maître d’école n’est autre que son père. Mais Gérald n’aime pas beaucoup l’école ou, peut-être plutôt la méthode utilisée pour apprendre à lire, écrire et assimiler le calcul
S’il a eu maille à partir avec l’école, celle du moins que son père envisageait pour lui, c’est en partie du fait de ce pied-bot qui lui fait vivre un véritable enfer face à ses camarades de classe. Désormais, il a finalement trouvé sa voie et va s’installer dans l’écriture. À 19 ans il quitte le lycée et mène une vie de bohème loin du toit paternel. C’est alors que, fugue après fugue, il entre en rébellion contre son père, vit de toutes sortes de petits boulots tout en pensant à butiner ces fleurs si diverses de la poésie française. Au milieu des années 1950, il publie ses premiers poèmes et, tout aussitôt remarqué, il commence alors une véritable carrière de poète sous le nom de Tchicaya U Tam’si. Il connaît à 25 ans la gloire littéraire, mais malgré la tendresse presque paternelle d’un Senghor, il aura des rapports de type œdipien avec les pères de la négritude qui lui font de l’ombre et qu’il veut symboliquement tuer après avoir « tué » le père biologique avec lequel, néanmoins, il se réconcilie tout aussi symboliquement à travers la figure presque mythique de Lumumba, dont il vit, presque dans la chair, les tragiques et derniers instants de la passion à Kinshasa. Lumumba est assassiné le 16 janvier 1961, tandis que le député Jean Félix-Tchicaya, père du poète, meurt le lendemain des suites d’une maladie... Le Mauvais Sang, Feu de brousse, À triche cœur et Épitomé sont alors les œuvres majeures du poète qui, désormais, apparaît non seulement comme l’enfant terrible de la poésie noire, mais également le plus doué de sa génération. En 1966, c’est la consécration avec le Grand Prix de poésie du Festival mondial des arts nègres à Dakar pour Épitomé... Mais Tchicaya rêve surtout de décrocher le Graal suprême, le prix Nobel de littérature, dès lors que son nom est cité parmi les nominés et surtout parce qu’il pense le mériter plus que quiconque, à commencer par le concurrent anglophone. On lui préfère Soyinka à qui il n’en veut pas tant qu’à l’ombre de Senghor qui a toujours plané dans ce monde francophone qu’il dominait de tout son poids tutélaire jusqu’à étouffer les moindres velléités de gloire littéraire susceptible d’éclore en dehors de sa sphère d’influence... C’est ce destin tragique de l’un des plus grands poètes de la francophonie que Boniface Mongo-Mboussa s’est mis à défricher, à déchiffrer à travers une patiente enquête nourrie d’archives et d’anecdotes familiales, mais aussi de témoignages d’écrivains. Et, surtout, inédite, la précieuse correspondance du poète avec Mambou Aimée Gnali, sa cousine, sa confidente. L’ouvrage que nous offre BMM prend, à la lecture, une allure de roman avec ses intrigues palpitantes, ses péripéties et ses rebondissements qui font toute la matière d’une vie, mais une vie de poète maudit. La « malédiction » est un concept vague et flou (celle de Pouchkine, par exemple, est controversée, tandis que celle de la plupart des écrivains russes de sa génération et des générations ultérieures, comme celle de Tsvétaïéva, est évidente), mais à travers cette démonstration in absentia que fait l’auteur, on peut gager qu’il s’agit avant tout de démontrer une singulière inadéquation entre la richesse d’une œuvre et l’état d’abandon dans lequel son créateur se trouve de par la réception qui est faite de celle-ci. Le fait, même, qu’il ait « échappé à la plupart des grands prix littéraires » (Tati Loutard, cité par F. Marthouret), souligne avec force ce décalage qui en fait un « maudit » au sens littéraire du terme et même davantage : au sens où l’on entend ce mot dans la littérature russe (si francophile !).
Mais alors, que vient faire, ici, la littérature russe, pourrait se demander le lecteur ? C’est précisément à ce point de la lecture, que BMM inaugure une manière de réflexion sur ce qu’aurait pu, ce qu’aurait dû être la fortune littéraire de Tchicaya U Tam’si, s’il avait appartenu à la patrie de Pouchkine. Et cette réflexion amorcée dans l’« Ouverture » du livre se clôt par la surprenante éviction de Rimbaud, en faveur de Tsvétaïéva, selon un fil comparatiste aussi peu rigoureux que celui qui instituait un « Rimbaud noir » de bon aloi. Or, la légitimité d’une telle approche, à supposer qu’elle étonne par ce curieux détour permis par la perspective Nevski, gageons qu’elle fut augurée par le poète de Mpili lui-même, lorsqu’il déclarait aux Chemain : « Je suis donc parti. Ce n’était pas Rimbaud. C’était plutôt Gorki. » (« Les grandes réussites lyriques : entretien avec Tchicaya U Tam’si », par A. et R. Chemain in Notre Librairie n° 38, p. 35) Et notre slaviste de corriger : point tant Gorki que Tsvétaïéva. Souhaitons, du moins, que telle mise en parallèle, parce qu’elle recèle une russophilie un rien spécieuse, fasse l’objet d’un ouvrage ultérieur, tout aussi palpitant que le ci-devant Viol de la lune... qu’il faut lire à tout prix ! Tchicaya U Tam’si, le viol de la lune : vie et œuvre d’un maudit, par Boniface Mongo-Mboussa, Paris, Vent d’ailleurs, 2014, 130 p. R. S. Tchimanga |


 Lorsqu’il arrive en France avec toute sa « tribu » de frères, sœurs et cousins, il a 15 ans et, n’ayant pas le niveau des élèves de son âge, il est placé chez les « plus grands », ce qui aggrave ses difficultés à suivre. On le confie alors à un répétiteur féru de belles lettres, grâce auquel il découvre la poésie et récite par cœur des poèmes entiers. C’est ainsi qu’il fait ses premiers pas en poésie, publie dans la revue Liaison ses premiers poèmes sous un pseudonyme.
Lorsqu’il arrive en France avec toute sa « tribu » de frères, sœurs et cousins, il a 15 ans et, n’ayant pas le niveau des élèves de son âge, il est placé chez les « plus grands », ce qui aggrave ses difficultés à suivre. On le confie alors à un répétiteur féru de belles lettres, grâce auquel il découvre la poésie et récite par cœur des poèmes entiers. C’est ainsi qu’il fait ses premiers pas en poésie, publie dans la revue Liaison ses premiers poèmes sous un pseudonyme.